Awen — Wikipédia
L'awen est un concept propre aux traditions poétiques des peuples celtiques du rameau brittonique. Il désigne en gallois, cornique et breton l'inspiration poétique et musicale comme un souffle divin qui parcourt le poète ou le musicien.
Le mot apparaît encore dans le troisième couplet de l'Hen Wlad fy Nhadau, l'hymne patriotique gallois.
Étymologie
[modifier | modifier le code]Le mot awen dérive de la racine indo-européenne *wel-, qui porte l'idée de « souffler »[1]. Il a la même origine que le mot awel qui signifie « brise » en gallois et « vent » en cornique[2]. Le mot est donc sous-tendu par la même idée de souffle que le mot « inspiration »[3].
La première attestation du mot apparaît dans l’Historia Brittonum de Nennius, moine compilateur des traditions historiques des royaumes brittoniques, au IXe siècle[4].
Le mot existe en gallois, en cornique et en breton avec le sens d'« inspiration poétique ou musicale, muse »[4].
Quelqu'un d'inspiré en tant que poète ou que prophète est appelé awenydd, awenyddion. Dans son utilisation actuelle en gallois, awen est parfois utilisé pour désigner un poète ou un musicien. Awen est aussi devenu un prénom masculin ou féminin dans les pays anglophones, ainsi qu'en Bretagne.
L'awen dans la tradition poétique galloise et brittonique
[modifier | modifier le code]La référence à l'awen comme un souffle divin qui inspire le poète apparaît souvent dans le Livre de Taliesin. Il s'agit d'un pouvoir surnaturel[5].
Giraldus Cambrensis, prêtre et écrivain d'origine galloise du XIIe siècle, témoin précieux sur le pays de Galles de son temps, montre que ce souffle divin pouvait devenir une véritable possession divine[6] : dans certaines conditions, les poètes inspirés pouvaient entrer en transe[5].
Plusieurs poètes gallois de l'époque chrétienne ont invoqué Dieu pour recevoir l'awen : un anonyme dans un poème en l'honneur du barde Cuhelyn Fardd[7] (XIIe siècle) ; toujours au XIIe siècle, le "saint barde de Brecon" (Gwynbardd Brycheiniog), en commençant une ode à saint David, demande au Seigneur au milieu de la nuit de lui accorder l'inspiration (awen) en même temps que la brise (awel) de l'aube qui se lève[5].
L'importance de l’awen dans la culture galloise n'a pas disparu. En témoigne sa présence dans l'Hen Wlad fy Nhadau, l'hymne patriotique gallois, qui fait une large place aux poètes, aux chanteurs et à la langue nationale ; on le trouve au troisième vers du troisième couplet :
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.
Le don poétique n'est pas entravé par la main hideuse du traître,
Ni la mélodieuse harpe de mon pays.
L'awen dans les courants néodruidiques
[modifier | modifier le code]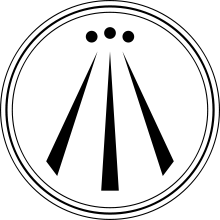
L'awen occupe une place importante dans les courants néodruidiques modernes et contemporains. Le mot y est en effet utilisé, d'une manière plus générale, pour évoquer la connexion ou le lien avec le divin. Selon Nicolas Boissière[8], « le terme awen, mot gallois généralement traduit en français par « inspiration », renvoie à un concept très important dans les cosmologies néodruidiques. Pour les néodruides en effet, ce terme… désigne à la fois la force de vie contenue dans toutes les choses de l'Univers et l'inspiration que les divinités envoient aux humains. Dans la plupart des cérémonies néodruidiques, le mot est chanté par trois fois au moment de commencer le rituel, en le décomposant en « aa-oo-en ». »
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ À ne pas confondre avec la racine *wel-, « vouloir ».
- ↑ A.O.H. Jarman (éd.), A guide to Welsh literature, vol. 1, chap. 1. Calvert Watkins, « Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse », Celtica, 6, 1963, p. 216.
- ↑ Le premier sens figuré donné par le Dictionnaire de l'Académie (9e édition) pour ce mot est : « Souffle divin qui anime l’esprit d’une sorte de transport et pousse à quelque action, suggère quelque discours. Être saisi d’une inspiration divine. Inspiration du ciel, de Dieu, d’en haut. L’inspiration des prophètes, des auteurs sacrés. Des inspirations surnaturelles. » ; il implique un pouvoir surnaturel.
- Ranko Matasović, Etymological Dictionary of Proto-Celtic, Leyde / Boston, Brill, 2009, p. 47. (ISBN 978-90-04-17336-1)
- Morton W. Bloomfield, Charles W. Dunn, The Role of the Poet in Early Societies (1992), p. 80-82 (en ligne).
- ↑ Descriptio Cambriae, I, 16.
- ↑ R. Geraint Gruffydd, « A Poem in praise of Cuhelyn Fardd », Studia Celtica, 10-11, 1975-1976, p. 198-209.
- ↑ Nicolas Boissière, « Célébrer un nouveau Soi. Rites de passage, créativité rituelle et dynamiques identitaires dans le néopaganisme au Québec », in Martine Roberge et Denis Jeffrey (dir.), Rites et ritualisations, Presses de l'université Laval, 2018, p. 88, n.7.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- (en) Morton W. Bloomfield, Charles W. Dunn, The Role of the Poet in Early Societies, Cambridge, D. S. Brewer, 2e éd. 1992, chap. V, p. 78 et suiv. (ISBN 9780859913478)
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]


 French
French Deutsch
Deutsch